PREUX-AU-BOIS ▐ POURQUOI CES SOBRIQUETS ?
Les mariages avec des étrangers étaient rares, et quand cela se produisait, c'était avec quelqu'un d'une commune voisine. Tout le monde se connaissait, se fréquentait, se tutoyait en s'appelant par des noms amicaux de remplacement, un surnom familier comme on aurait pu le faire avec ses proches : c'était le sobriquet. Nos ancêtres, au début du 1er millénaire, ne portaient qu'un seul nom semblable à notre prénom actuel, souvent le nom d'un saint. Ce n'est que vers le XIe siècle, pour éviter les homonymes, que l'on commença à donner un autre nom, un « surnom » qui est notre nom de famille d'aujourd'hui. Les Anglais ont d'ailleurs conservé ce premier sens en utilisant le terme « surname » pour le nom de famille. Au début, on précisait simplement en y ajoutant le nom du père (Jean fils de Paul a donné Jean-Paul) ou le métier (Brasseur), ou l'origine géographique (Dubois) ou une particularité physique (Lebrun) ou une référence à une anecdote personnelle (Leriche). C'est ce même principe de formation du nom qui a abouti à la création de sobriquets. A l'opposé du prénom qui est choisi par les parents et qui est toujours avantageux ou flatteur, le sobriquet est imposé par les amis ou les voisins et ne s'embarrasse pas de plaire, il est même le plus souvent moqueur et railleur. Et c'est sans doute là, la véritable origine du sobriquet : le sens de l'humour qui était un des traits dominants de nos ancêtres. L'écrivain, René Jouglet, dans son récit de jeunesse autobiographique « Les Paysans », nous dépeint la gaieté des chantiers de Mormal et « l'allégresse de ces hommes dans les bois ». |
||
 |
Nos ainés avaient un goût prononcé pour la blague, la taquinerie, et de ce fait les surnoms attribués étaient souvent plaisants, mais encore plus souvent péjoratifs. Ils étaient, apparemment, toujours bien acceptés. Ils reprenaient (et reprennent encore) : - des particularités physiques : les Pasroux (cousins des Roux) mais eux-mêmes ne l'étaient pas. - des particularités physiques et généalogiques : les Blancslalie : des personnes très blondes dont la grand-mère se prénommait Eulalie. - des fonctions : el militaire : avait été soldat aux Dardanelles. les sodars : soldats - el caporal : le caporal. |
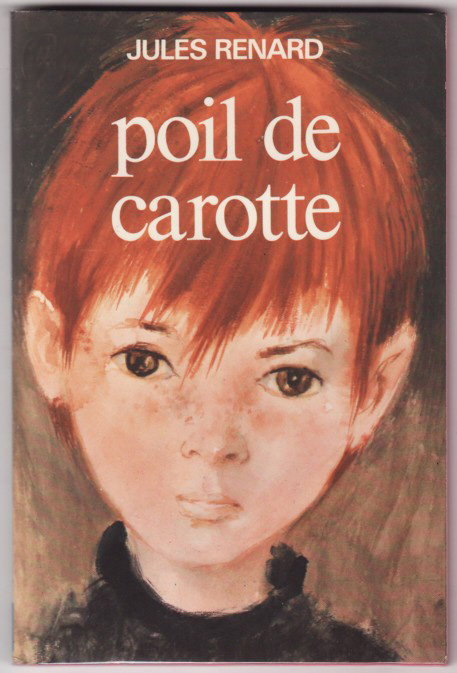 |
Eugène du Sapeur : ancien maire Les « Sapeurs » : l'arrière-grand-père de la famille avait été soldat du génie (ou sapeur) lors de la campagne de Russie et en était rentré à pied avec une énorme barbe. Eugène du Sapeur, un descendant, a été maire par intérim de la commune de Preux-au-Bois pendant la seconde guerre mondiale. La lignée des Sapeurs s'est éteinte en 1977 avec Jeanne du Sapeur. Il semblerait donc que les sobriquets ne se transmettent pas systématiquement et qu'ils se créent et disparaissent au gré des générations. Il pouvait y avoir plusieurs sobriquets dans la même famille, alors que d'autres n'en possédaient aucun. Les sobriquets sont des expressions de la vie de tous les jours, évidemment en patois, utilisés selon le bon gré de chacun et dont une anecdote en était bien souvent la source. Certains sobriquets ont des origines qui resteront toujours obscures, tout comme l'origine même du mot « sobriquet » qui reste une énigme. Il nous vient du XIVème siècle avec la signification de « coup de menton » et on ne sait trop pourquoi il prit son sens actuel. Le patois est support naturel des sobriquets et tant que le patois sera parlé, il restera des sobriquets dans nos villages. En ce qui concerne la région avesnoise, on lui connaissait beaucoup de sobriquets dont celui-ci peu reluisant « la queue du Baudet » pour qualifier la fin du département du Nord. Et d'après les recherches effectuées par un historien de la région de Fourmies, il faut savoir qu'au XIXème siècle, quand on citait l'Avesnois, on évoquait également « la Sibérie de la France » eu égard à son enclavement et son climat très rude. Les choses ont un peu évolué et on entend depuis parler de la Petite Suisse du Nord… |
||
Catherine Marsy |
||